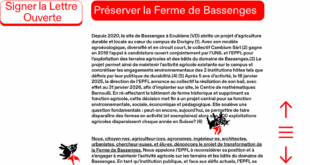Table des matières
Dernière modification le 12-1-2023 à 15:39:04
[lecture] Un livre tragique à plus d’un titre, mais pas que…
La Tragédie des Communs, Garrett Hardin, PUF, 2018. Textes originaux : The Tragedy of Commons, Science, 1968 & Extension of the Tragedy of Commons , 1998. Préface et critique par Dominique Bourg.
 Dans mes longs périples de lectures et de visionnage en tout genre, j’ai entendu parler plus d’une fois de cette fameuse « Tragédie des Communs » de Hardin : ce que j’en entendais était qu’il concluait que la liberté au sein d’un bien commun conduit tout le monde à sa perte. Ce qui a été repris à bon compte par la pensée libérale : les communs ne seraient donc pas viables et seraient surtout pires que tout, la propriété privée (notion de biens rivaux et biens exclusifs) pouvant seule garantir un usage durable. Bref, il s’agit d’un article qui a fait grand bruit à l’époque et qui a été, comme bon nombre d’autres ouvrages, réduit à cette seule conclusion, pour le moins dommageable, nous le voyons aujourd’hui.
Dans mes longs périples de lectures et de visionnage en tout genre, j’ai entendu parler plus d’une fois de cette fameuse « Tragédie des Communs » de Hardin : ce que j’en entendais était qu’il concluait que la liberté au sein d’un bien commun conduit tout le monde à sa perte. Ce qui a été repris à bon compte par la pensée libérale : les communs ne seraient donc pas viables et seraient surtout pires que tout, la propriété privée (notion de biens rivaux et biens exclusifs) pouvant seule garantir un usage durable. Bref, il s’agit d’un article qui a fait grand bruit à l’époque et qui a été, comme bon nombre d’autres ouvrages, réduit à cette seule conclusion, pour le moins dommageable, nous le voyons aujourd’hui.
Dernièrement, dans l’excellentissime Illusion Financière de Gaël Giraud (voir mon résumé, un peu long, ici : etatdurgence.ch/blog/chroniques/illusion-financiere/), il s’est rappelé à mon souvenir, Gaël Giraud écrivant un plaidoyer pour le retour aux communs : le travail, la terre et la monnaie. On y reviendra plus tard… tout comme un critique de l’article en question sous divers aspects…
Bon, ça raconte quoi, exactement cette « Tragédie » ?
La démographie comme point de départ
 Il part du principe, sans trop s’y attarder, que depuis longtemps et en presque chaque occasion, les solutions techniques sont parvenues à venir à bout des problèmes humains, et qu’elles sont donc souhaitables. D’emblée il développe un point de vue qui le rangera assez vite dans le courant Malthusien : il y a une problématique humaine qui est sans aucune solution technique : la démographie. En effet, la plupart des gens veulent éviter les maux de la surpopulation mais sans renoncer à aucun privilège ni confort. Or, et ça paraît trivial, dans un mon fini, la part par personne doit nécessairement décroitre si la population augmente, le monde fini ne pouvant nourrir qu’une population finie, la croissance démographique doit nécessairement être égale à zéro, à un moment donné.
Il part du principe, sans trop s’y attarder, que depuis longtemps et en presque chaque occasion, les solutions techniques sont parvenues à venir à bout des problèmes humains, et qu’elles sont donc souhaitables. D’emblée il développe un point de vue qui le rangera assez vite dans le courant Malthusien : il y a une problématique humaine qui est sans aucune solution technique : la démographie. En effet, la plupart des gens veulent éviter les maux de la surpopulation mais sans renoncer à aucun privilège ni confort. Or, et ça paraît trivial, dans un mon fini, la part par personne doit nécessairement décroitre si la population augmente, le monde fini ne pouvant nourrir qu’une population finie, la croissance démographique doit nécessairement être égale à zéro, à un moment donné.
Plus précisément, il se demande si l’on peut atteindre l’objectif de Bentham : « Le Plus grand bien pour le plus grand nombre ». Et donne la réponse d’emblée : « non », pour deux raisons.
- Il n’est pas possible mathématiquement de maximiser deux variables en même temps
- Un fait biologique (Hardin est biologiste) : pour vivre, un être humain doit avoir une source d’énergie, qui a deux buts : l’entretien (le bon fonctionnement de l’organisme, indispensable pour éviter la mort prématurée) et le travail (faire quelque chose avec cet organisme). Dès lors si on veut maximiser la population, il faut que les calories de travail se rapprochent autant que possible de zéro.
Les biens et les hommes
Il soutient que vouloir le maximum de bien par personne est de toute manière inconcevable car ce « bien » diffère selon chaque personne. Cela lui fait dire qu’il est illusoire de penser que les décisions individuelles sont forcément les meilleures pour la société (on voit déjà ici que le la pensée libérale a judicieusement choisi des extraits précis pour justifier son crédo de propriété privée…). Il s’agit donc bien, selon lui, de réexaminer nos libertés individuelles pour voir lesquelles sont défendables.
Une prairie et des hommes…
Et d’y aller de ce pas avec son fameux exemple de la prairie ouverte à tous : on peut s’attendre à ce que chaque personne tente d’y faire paître un maximum de bétail. Pendant un temps, tout se passe bien car la population reste restreinte : les maladies, les guerres, les famines régulent la démographie, mais vient un jour où une paix durable et un ordre social stable fait son apparition. La population se met à augmenter, et c’est là que la tragédie se joue : chaque éleveur cherchant à maximiser son troupeau, on en arrive rapidement à un problème de surpâturage, bien entendu.
Voici venir un autre écueil que le libéralisme (et surtout le néolibéralisme qui a suivi) a bien passé sous silence : d’une part chaque éleveur a tout intérêt à faire paître le plus de bêtes possibles puisque le gain lui revient directement, et d’autre part les effets du surpâturage sont partagés entre tous les éleveurs (vous voyez : privatisation des gains, mutualisation des pertes : c’était déjà là, en tant que problème fondamental sous-jacent !). Le résultat étant que chaque bête rapportant moins à cause du manque de pâture, le choix rationnel de chaque éleveur est d’ajouter des bêtes pour compenser, tous courant donc à la ruine poursuivant leur intérêt personnel. En d’autres termes, la liberté des biens communs se traduit par la ruine de tous.
Alors, que faire ?
Hardin fait le parallèle avec les ressources halieutiques, les parkings gratuits, et les parcs nationaux : tout cela est voué à la ruine et la destruction selon lui, pour la raison de la maximisation de l’intérêt personnel. Sauf si… tout cela est considéré comme un bien public mais qu’on décide de ne laisser passer que certaines personnes, on y ouvre l’accès au mérite, ou avec un système d’enchère (basé sur la richesse donc), gagner un accès à la loterie, ou encore premier arrivé, premier servi, … peu importe mais pour lui il faut choisir une régulation au risque de perdre le bien commun.
Et la pollution ?
Il fait le même raisonnement, de manière inversée, sauf que l’air et l’eau ne peuvent être clôturés, ou faire l’objet d’un accès réservé. Et que donc il n’est pas possible d’en restreindre l’accès d’une quelconque manière. Dès lors la notion de bien privé aggrave la pollution : à nouveau, au profit privé s’ajoute la collectivisation des externalités. Ce n’est pas un souci quand il y a peu de population, mais c’en devient un énorme quand elle commence à exploser…
C’est là qu’entre la notion de loi et de tolérance : la population a besoin de règles strictes, avec une tolérance qui dépend du moment où l’acte est commis. Les mêmes règles et tolérances ne peuvent s’appliquer selon qu’on est quelques millions ou quelques milliards… Et soulevant l’épineux problème de qui légifère : qui contrôle ceux qui font les lois ? Il cite John Adams : « Il nous faut un gouvernement de lois et non d’hommes », sans quoi on ouvre la porte à toutes les corruptions et intérêts personnels (tiens donc, on dirait qu’il a vu venir les lobbies et les conflits d’intérêts massifs que nous connaissons aujourd’hui).
Sa tragédie des biens communs se termine donc ainsi : chacun étant poussé par son intérêt personnel, laisser des communs sans lois (dépendant d’une époque et d’un contexte) et sans contrôle sur celles-ci mène immanquablement à la destruction pure et simple du bien commun : tout le contraire de la récupération (néo)libérale qui en a été faite pour promouvoir le bien privé avant toute chose… bref, une lecture de droite somme toute assez éloignée de ce qu’a réellement écrit Hardin. Quoi que… la suite justifie peut-être une telle lecture.
Car il ne s’arrête pas là !
Pour lui, un autre aspect tragique des communs est « la liberté d’enfanter » (voilà Malthus qui revient au galop). Il va plus loin encore : p.39 « Lier le concept de liberté d’engendrer à la conviction que tout être né possède un droit égal aux biens communs, c’est emprisonner le monde dans un tragique programme d’action ». Il attaque frontalement les Nations-Unies et la déclaration universelle des droits de l’homme : pour lui, cette déclaration est totalement irréaliste, puisque trop de gens sur terre limite de facto l’accès aux ressources de tous les autres.
A moins d’en appeler à la conscience de chacun, qui se limiterait de lui-même pour laisser l’accès aux communs à tous les autres de manière égalitaire, ce qu’il réfute immédiatement : pour lui, ce serait « créer un système sélectif qui œuvrerait en vue de l’élimination de toute conscience morale au sein de la race (sic). En effet, pour lui, si on s’en tient au bon vouloir de chacun, certains le feront, et d’autres pas. Dès lors ceux qui ne le font pas élimineraient avec le temps ceux qui le font, et transmettraient ce comportement aux générations suivantes (bon, il n’en fait aucune démonstration, il se base je pense uniquement sur une réduction de biologiste un peu exagérée pour le coup).
Alors que faire ? Jouer sur la bonne conscience de chacun ? Trop anxiogène et pathogène. La coercition mutuelle par consentement mutuel ? Ce serait une meilleure piste, s’il ne proposait pas le fait qu’on puisse l’utiliser pour justifier que les communs ne le sont en fait pas… Car c’est cela qu’il sous-entend : la meilleure manière que les communs de soient pas détruits est bien que qu’on s’organise pour… qu’il n’en existe pas ! Aussi simple que ça, et ici, on voit comment l’idéologie libérale a pu être séduite par le texte… Il précise quand même qu’il n’est pas nécessaire d’aimer cette idée, mais bien de l’accepter, dans le simple but d’échapper à « l’horreur des biens communs ».
L’option qu’il choisit de soutenir est donc la propriété privée et l’héritage légal, même s’il admet que ce n’est sans doute pas très réjouissant : ceux qui sont biologiquement plus aptes à être les gardiens de la propriété et du pouvoir devraient légalement en hériter d’avantage… Ca me rappelle le très bon bouquin de Waterstone et Chomsky « les conséquences du capitalisme », dont mon résumé est ici (etatdurgence.ch/blog/chroniques/les-consequences-du-capitalisme/). Il admet que c’est injuste, mais « mieux vaut l’injustice que la ruine totale » (p.49).
C’est donc ici le début – ou à tout le moins la confirmation – d’un récit libéral (qui deviendra néolibéral) : les plus méritant sont ceux à qui doit revenir le bien commun, et ils en reçoivent le droit d’usage privé, au détriment de ceux qui n’ont pas été capables d’être « performants ». On comprend mieux pourquoi cet article est tant et tant cité : il jette réellement les bases de la mainmise du privé, justifiée par l’incapacité du premier venu à gérer correctement les communs.
Ses conclusions…
Il résumé lui-même son idée ainsi : « les biens communs, s’ils sont justifiables, ne le sont que dans des conditions de faible densité de population. Comme la population a augmenté, il a fallu abandonner les biens communs dans divers domaines les uns après les autres » : collecte de nourriture en clôturant les terres agricoles ; les déchetteries pour la pollution (on ne met plus tout n’importe où), idem en matière de plaisirs.
Cette dernière phrase m’a laissé songeur, et qui pose un sérieux problème actuellement (ce qui me fait dire encore une fois que les fondements de l’idéologie libérale a pratiqué le cherry picking avec Hardin) : il cite Hegel avec « La liberté consiste à reconnaitre la nécessité ». C’est peut-être la partie la plus actuelle du bouquin (mais Hardin ne pouvait le savoir) : nous sommes en train de pinailler pour savoir si, oui ou non nous devons accepter de rouler moins vite sur les routes (liberté de vitesse), ne plus prendre l’avion pour les vacances (liberté et plaisir de distance et dépaysement), et dans le désordre : manger moins de viande, ne pas posséder de piscine privée, un ou plusieurs véhicules, un nombre incalculable d’appareils électriques et électroniques et j’en passe… certes j’entend déjà les grincheux me dire qu’il s’agit là de biens privés et non communs, mais tout de même : les plaisirs des biens privés sont maintenant revendiqués comme la norme, ce qui doit valoir pour tout le monde. Dès lors est-ce que ça ne deviendrait pas un « bien commun » ? Le bien commun d’utiliser les réseaux aéroportuaires, les chaines de supermarchés, … : c’est ça qu’on nous vend comme norme…
Il termine en citant à nouveau Hegel, je le répète donc également : « La liberté consiste à reconnaître la nécessité », à quoi il répond en guise de toute dernière phrase : « le rôle de l’éducation est de révéler à tous la nécessité d’abandonner la liberté d’engendrer. C’est seulement ainsi que nous pourrons mettre fin à cet aspect-là de la tragédie des communs ».
EXTENSION de la Tragédie des communs :
En 1998, Hardin reviendra sur cet article et sur les réactions qu’il a suscité. Pour dire pas grand-chose, en vrai, si ce n’est deux choses d’une importance capitale à l’heure actuelle et aux lumières des bouleversements que nous vivons, et qui remet en cause une grande partie de son texte original.
D’une part il précise : l’individualisme nous est cher parce qu’il produit la liberté, mais ce don est conditionnel : plus la population dépasse les capacités de l’environnement, plus il faut abandonner de libertés.
D’autre part il reconnait une erreur majeure dans sa conception des communs : il « juste » omis de préciser qu’il s’agissait de communs « non gérés »… Sauf qu’il s’empresse de définir un bien géré par soit le socialisme, soit le « privatisme de la libre entreprise ».
 État d'urgence Ce qu'en dit la science
État d'urgence Ce qu'en dit la science