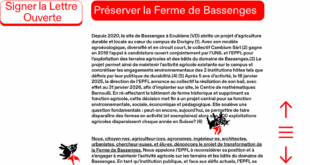Table des matières
« La solution, c’est le vivant ! »
Marc-André Sélosse, biologiste et professeur au Muséum d’histoire naturelle, met en lumière l’urgence de réorienter nos pratiques agricoles vers des solutions basées sur le vivant. En adoptant des approches comme le compostage, les intercultures et la réduction des intrants chimiques, il est possible de restaurer les sols, d’atténuer le changement climatique et de préserver la biodiversité. Marc-André Sélosse expose les bienfaits d’une approche centrée sur le vivant pour répondre aux défis agricoles et climatiques. Voici les principaux points abordés :
Les limites du labour
- Le labour intensif détruit la structure des sols, tue la vie microbienne et libère du carbone sous forme de CO₂, contribuant ainsi au changement climatique.
- Depuis les années 1950, les sols européens ont perdu la moitié de leur matière organique, ce qui aggrave l’érosion et la perte de fertilité.
Le programme « 4 pour 1000 »
- Ce programme propose d’augmenter annuellement de 0,4 % la teneur en matière organique des sols pour compenser les émissions de gaz à effet de serre.
- Bien qu’il soit difficile de le mettre en œuvre partout, il offre une piste prometteuse pour stocker du carbone et revitaliser les sols.
Solutions agricoles écologiques
- Matière organique et compostage : Incorporer des déchets organiques dans les sols, planter des intercultures en hiver, et broyer ces cultures avant le semis printanier.
- Ces pratiques augmentent la rétention d’eau, réduisent l’érosion, et servent d’engrais naturel en libérant de l’azote et du phosphate.
Bénéfices pour la biodiversité
- L’agriculture biologique favorise le retour des pollinisateurs, augmentant les rendements de certaines cultures comme le cassis (+20 %).
- L’abandon de pesticides et le soutien à des pratiques naturelles renforcent la santé des écosystèmes agricoles.
Un appel à un changement de paradigme
- Sélosse critique les solutions technologiques (comme les drones pollinisateurs), soulignant qu’elles ne remplacent pas les services écosystémiques offerts par la nature.
- Il appelle à une « acculturation violente » pour revaloriser le vivant et sortir de la dépendance aux approches chimiques et technologiques.
Risques d’inaction
- Plus on tarde à adopter ces pratiques, plus les problèmes s’aggravent : déclin de la biodiversité, érosion des sols, et intensification des crises climatiques.
- Il met en garde contre la montée possible d’une violence militante face à l’inaction prolongée des gouvernements.
Un message d’espoir
- Marc-André Sélosse reste optimiste quant aux solutions offertes par le vivant. Il souligne que de nombreuses initiatives locales prouvent déjà leur efficacité.
- Il croit en l’éducation des générations futures pour promouvoir un changement culturel et environnemental durable.
Et la Suisse ?
Repenser notre responsabilité envers l’agriculture écologique en Suisse
L’agriculture écologique, grâce à des pratiques comme le non-labour et la valorisation de la matière organique, offre des solutions prometteuses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, restaurer les sols et préserver la biodiversité. Pourtant, comme l’explique Marc-André Sélosse, biologiste et professeur au Muséum d’histoire naturelle, ces approches peinent à trouver un écho suffisant auprès des décideur·euses politiques et des structures agricoles. En Suisse, où l’agriculture bénéficie d’un soutien important et d’une forte tradition biologique, les défis et opportunités sont légèrement différents mais tout aussi cruciaux.
Adaptation au contexte suisse : les spécificités locales
En Suisse, l’agriculture biologique représente une part plus importante des surfaces cultivées qu’en France, avec environ 17 % des terres agricoles en bio contre 10 % en France (1). Ce positionnement en fait un pays pionnier dans ce domaine, mais de nombreux obstacles persistent.
Les grandes exploitations intensives, particulièrement dans les plaines suisses, continuent d’appliquer des pratiques de labour intensif et d’utiliser des produits phytosanitaires, en dépit des efforts de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). En tant que centre de compétences de l’agriculture et du secteur agroalimentaire, l’OFAG œuvre activement à promouvoir des pratiques durables (2).
L’OFAG veille à ce que les paysan·ne·s produisent des denrées alimentaires de haute qualité tout en préservant les ressources naturelles indispensables, telles que le sol, l’eau et l’air. Ses initiatives, comme les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) et le Plan d’action Produits phytosanitaires, visent à encourager une agriculture respectueuse de l’environnement.
Toutefois, malgré ces belles paroles et ces mesures, les impacts sur la biodiversité demeurent préoccupants.
La biodiversité agricole continue de s’éroder : les insectes, les oiseaux et d’autres mammifères disparaissent à un rythme alarmant. Les paysages agricoles suisses, souvent marqués par l’absence de haies et la fragmentation des habitats, peinent à soutenir une faune et une flore diversifiées.
Bien que l’OFAG mette en œuvre des politiques agricoles novatrices, comme la rétribution des prestations écologiques via des paiements directs, les résultats actuels montrent que ces efforts sont encore insuffisants. La loi sur l’agriculture (LAgr), en vigueur depuis 1999, offre un cadre législatif pour soutenir des pratiques plus durables, mais elle doit être renforcée pour mieux répondre à l’urgence écologique.
Face à ces constats, il est crucial que la Suisse intensifie ses efforts pour équilibrer productivité et préservation de la biodiversité. Cela pourrait inclure la promotion accrue des systèmes agroécologiques, l’élargissement des surfaces de promotion de la biodiversité, et une révision des politiques favorisant l’agriculture intensive.
Des solutions concrètes pour la Suisse
Comme en France, les méthodes préconisées par Marc-André Sélosse sont adaptées au contexte suisse. Parmi elles:
- Compostage et valorisation des déchets organiques : Les ménages suisses participent déjà largement à la collecte de biodéchets, mais ceux-ci pourraient être davantage redirigés vers les sols agricoles après compostage.
- Intercultures en hiver : Dans les plaines de l’Aar ou du Plateau, où l’érosion est problématique, les cultures d’engrais verts ou d’intercultures pourraient être davantage encouragées, même dans les systèmes intensifs.
- Programme « 4 pour 1000 » : Bien que son application intégrale soit limitée par la topographie helvétique, ce programme illustre l’importance de préserver et d’enrichir la matière organique des sols. Dans les zones alpines et préalpines, des techniques spécifiques pourraient compléter cette approche.
La responsabilité collective : citoyens et institutions
Marc-André Sélosse insiste sur un point central : sans un soutien actif de la société, les transitions nécessaires resteront marginales. En Suisse, les consommatrices et consommateurs jouent un rôle clé dans l’encouragement de ces pratiques grâce à leur attachement aux produits locaux et biologiques. Cependant, ce soutien doit aller bien au-delà de l’acte d’achat.
Les citoyen·ne·s doivent s’impliquer de manière proactive pour soutenir les agriculteur·trice·s suisses face aux défis climatiques et environnementaux. Cela passe par une consommation réfléchie : privilégier les produits locaux et de saison, éviter les produits transformés ou importés lorsque des alternatives locales existent, et favoriser les circuits courts pour garantir une juste rémunération des paysan·ne·s. Il est également essentiel que la part de revenu consacrée à l’alimentation soit revalorisée, en réduisant les dépenses dans des biens superflus au profit d’une alimentation locale et durable.
Pour assurer que cette transition soit socialement juste, des mécanismes doivent être mis en place pour soutenir les personnes défavorisées. Cela pourrait inclure des subventions pour l’achat de produits locaux ou biologiques et la mise en place de coopératives alimentaires accessibles. Par ailleurs, la population aisée pourrait contribuer de manière solidaire à travers des taxes ciblées ou des dons dédiés au financement de ces aides, renforçant ainsi l’accès équitable à une alimentation durable pour tou·te·s.
De plus, les citoyen·ne·s peuvent jouer un rôle déterminant en votant pour des lois qui renforcent le soutien à l’agriculture durable. Par exemple, des mesures pourraient être adoptées pour limiter l’importation de produits concurrents hors saison, imposer aux grandes filiales de supermarchés des quotas clairs, ou même inciter la population valide à contribuer bénévolement à des tâches agricoles. Ces gestes concrets contribueraient à alléger la charge de travail des paysan·ne·s, en particulier dans un contexte où les méthodes respectueuses de l’environnement demandent davantage de main-d’œuvre.
Les associations agricoles suisses, bien qu’engagées sur certaines thématiques, pourraient intensifier leurs efforts pour promouvoir des pratiques agroécologiques. Cela pourrait inclure le soutien à la valorisation des déchets organiques en compost, la réduction des intrants chimiques ou la création de programmes pour la plantation de haies et la diversification des cultures. Ces actions aideraient les agriculteur·trice·s à répondre aux enjeux environnementaux tout en préservant la biodiversité.
Enfin, la population suisse doit reconnaître que demander moins de pesticides et des méthodes plus écologiques aux agriculteur·trice·s sans leur offrir un soutien concret revient à leur imposer un fardeau insoutenable. L’implication citoyenne, par des choix de consommation éclairés, un soutien politique et des mécanismes de solidarité, est essentielle pour garantir que l’agriculture suisse puisse répondre aux enjeux climatiques et environnementaux tout en assurant sa pérennité et son accessibilité à tous les ménages.
Facile à dire…
Le discours peut sembler simpliste. Il est vrai qu’en quelques lignes, il est difficile de développer un projet concret et détaillé. Cependant, il est tout aussi évident que poursuivre sur la voie actuelle ne permettra pas de répondre aux catastrophes environnementales en cours.
Prendre le taureau par les cornes implique d’élaborer un véritable plan d’urgence, à la fois efficace et soutenable, pour garantir la viabilité des générations futures. Pour ce faire, la Confédération suisse pourrait initier un programme ambitieux, rassemblant les forces vives de la nation. Les universités, l’OFEV, l’OFAG, les associations environnementales et agricoles, ainsi que les écoles d’agriculture devraient travailler main dans la main, au sein d’une taskforce dédiée, pour développer des solutions concrètes. Cette taskforce aurait pour mission de coordonner les recherches, de proposer des mesures immédiates et de garantir une approche intégrée des défis agricoles et environnementaux.
Une innovation majeure serait également de mettre en place une assemblée citoyenne (3), composée de citoyen·ne·s tiré·e·s au sort. Une fois formée et instruite grâce aux recherches scientifiques et aux données agricoles actuelles, cette assemblée pourrait formuler des propositions audacieuses et adaptées aux réalités suisses.
Réduire une telle démarche à une simple utopie serait non seulement un renoncement, mais aussi un gaspillage d’une opportunité unique. Ce projet représente un défi de taille, mais également une chance de rapprocher les citoyen·ne·s, de renforcer le lien social et de donner un nouvel élan de fierté à la population suisse. En relevant ce défi, la Suisse pourrait non seulement rester digne face aux crises écologiques, mais aussi devenir un modèle de résilience et d’innovation.
Qu’attendons-nous?
Le message de Marc-André Sélosse est clair : en continuant de négliger les solutions offertes par le vivant, nous augmentons la difficulté des défis futurs. En Suisse, où les pratiques écologiques sont déjà en avance sur d’autres pays, il est crucial de ne pas ralentir ces efforts. La transition agricole ne doit pas être vue comme un coût, mais comme une opportunité de garantir la résilience de nos écosystèmes et la sécurité alimentaire pour les générations futures.
Face à l’urgence climatique et à la dégradation des sols, la Suisse a les moyens d’être un modèle en matière d’agriculture écologique. Encore faut-il que les politiques publiques, les syndicats agricoles, et les consommatrices et consommateurs unissent leurs forces pour soutenir activement ces pratiques.
Peut-on aligner ce discours à la Suisse ? Certainement !
Bien que la situation française diverge de la Suisse, nous pouvons comprendre les similitudes qui s’alignent sur les propos ci-dessus.
Références
- En Suisse, l’agriculture biologique représentait 16,2% de la surface agricole utile en 2019, avec une légère augmentation à 16,8% en 2021.En France, la part des terres agricoles en bio était de 10% en 2023, marquant une légère diminution par rapport aux années précédentes.Ces chiffres illustrent une adoption plus prononcée de l’agriculture biologique en Suisse par rapport à la France.
agriculture.gouv.fr / ind.ge-en-vie.ch / bio-suisse.ch - Posez vos question à l’OFAG AgriBot, le chatbot de l’Office fédéral de l’agriculture
- Exemple : Avenir alimentaire de la Suisse – Assemblée citoyenne pour la politique alimentaire (2022)
 État d'urgence Ce qu'en dit la science
État d'urgence Ce qu'en dit la science