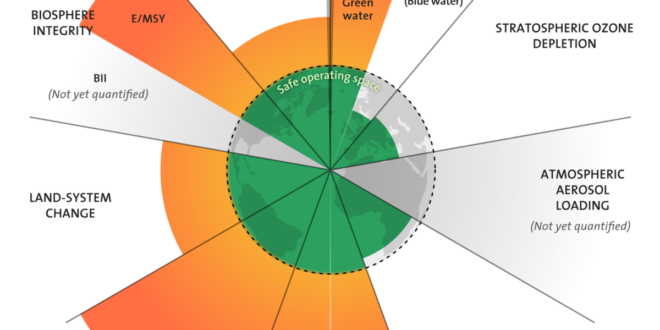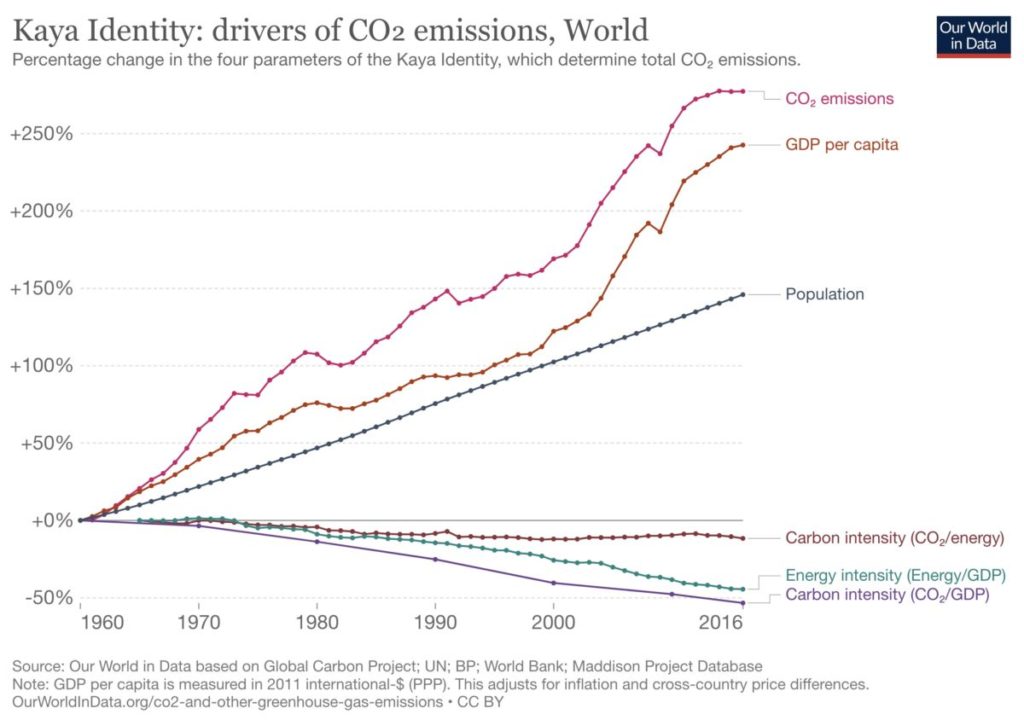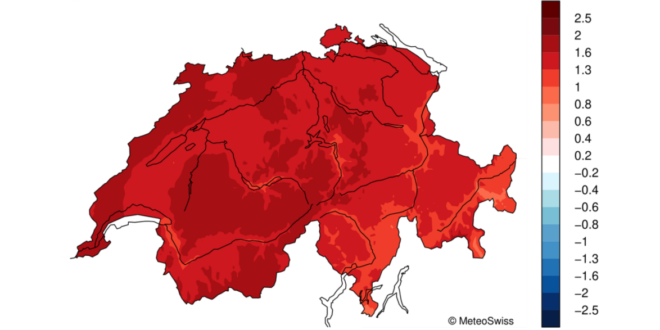USA, XXe siècle
Vous pensez peut-être que les villes américaines ont toujours été dédiées aux voitures thermiques individuelles, et que les transports publics électrifiés n’y ont jamais prospéré? Détrompez-vous! De nombreuses villes telles que Los Angeles, Saint-Louis, Baltimore ou encore Oakland étaient dotées d’un important réseau de trams au début du 20e siècle. Mais la politique d’étalement urbain (encouragées aussi bien par les gouvernements locaux et fédéraux que par des intérêts privés), et la prise de contrôle entre 1938 et 1950 par la National City Lines des compagnies de transports publics de 25 villes, eu tôt fait de ruiner l’attractivité des transports publics électriques, au profit de l’automobile individuelle thermique. Il faut savoir que la NCL comptait parmi ses actionnaires l’entreprise automobile General Motors, celle de pneus Firestone et celles d’essence Standard Oil of California et Phillips Petroleum. Ces entreprises n’avaient aucun intérêt à perpétuer un système basé sur le rail et l’électricité. Dans sa lutte contre la menace communiste, le gouvernement américain renforça sa politique de promotion d’un mode de vie individualiste, dont le stéréotype était la famille habitant une villa individuelle en banlieue, par opposition à l’ancien modèle urbain plus riche en interactions sociales.
Suisse, XXIe siècle
Mais pourquoi mentionner ce virage historique de la mobilité urbaine américaine, presque un siècle plus tard, sur un site web suisse? En 2022, la lutte contre le communisme fait sourire. Par ailleurs, nous n’extrayons aucun pétrole de notre sol. Et contrairement à nombre de pays voisins, nous n’avons aucune marque et aucune usine de production de voiture sur notre territoire. Les intérêts de ces secteurs semblent donc minimes en Suisse, car peu d’emplois sont directement concernés par ces filières. Et pourtant, de puissants lobbys œuvrent contre l’intérêt du plus grand nombre, en défendant l’intérêt de quelques distributeurs de mazout (Swissoil) ou importateurs de voitures (auto-suisse, qui représente entre autres les intérêts d’AMAG et d’Emil Frey).
Souvenez-vous, en 2020, les lobbyistes d’auto-suisse avaient réussi à édulcorer la loi CO2 débattue au parlement pour la rendre plus laxiste que ce qui se faisait chez nos voisins européens – et ce malgré l’impact négligeable que ces mesures pro-climat représentaient sur l’emploi dans notre pays. Plus généralement, cette faîtière combat toute mesure de protection de l’environnement dont la mise en œuvre pourrait prétériter le développement du trafic individuel motorisé.
Swissoil, quant à elle, a pour but de maintenir le commerce de combustibles libre et efficace. Elle s’oppose fermement au traitement préférentiel des autres agents énergétiques par les pouvoirs publics. Comprenez par là qu’elle lutte au niveau politique contre la promotion des énergies renouvelables, et contre toute régulation des émissions de CO2 dues aux énergies fossiles.
Comme un siècle auparavant aux USA, nous assistons aujourd’hui en Suisse à une convergence de forces et d’intérêts inédits en faveur de la mobilité individuelle basée sur le pétrole. En effet, le parlementaire fédéral UDC Albert Rösti, à la tête de SwissOil depuis 2015, vient de prendre la présidence d’auto-suisse. Ce choix des importateurs suisses de voitures n’augure rien de bon pour la décarbonation nécessaire de la mobilité dans notre pays. Il est à prévoir que des mesures progressistes de promotion des transports publics ou d’électrification de la mobilité seront durement combattues sous la coupole.
 État d'urgence Ce qu'en dit la science
État d'urgence Ce qu'en dit la science