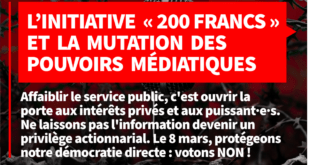Dernière modification le 20-9-2025 à 14:24:09
Le Monde des 31 mai, 1, 2, 3 et 4 juin 2022. « Surconsommation : l’impasse », Économie et entreprise, pp. 20-21, 18-19, 14-15, 18-19 et 18-19.
La précédente chronique annonçait la parution de cinq doubles pages du Monde consacrées à notre surconsommation générale, tout comme au caractère problématique que pose une transition devenue impérative. Mais comment donc, en un espace restreint, donner quelque idée de cette enquête tous azimuts ? Efforçons-nous pourtant.
Volet 1 : du dérèglement climatique.
Ce phénomène qui n’est plus à prouver implique désormais, on le sait, une prompte et radicale réduction des émissions de CO2. Or s’il est un fait avéré, c’est qu’à elles seules les innovations technologiques demeureront impuissantes à nous faire atteindre le « zéro émission nette » d’ici 2050. Nous avons trop longtemps traîné les pieds pour cela. Si bien que gagner en sobriété devient indispensable – un impératif impliquant, outre la baisse des températures de chauffage et la réduction de la vitesse de circulation sur les routes, d’autres mesures encore touchant à l’aménagement des villes et du territoire en sorte de rapprocher les domiciles des lieux de travail et de commerce ; au nombre d’habitants par mètre carré ; à la taille des véhicules ; au nombre de personnes par ménage ; à la consommation de viande, etc. Autant de facteurs participants de la même équation. Mais comment procéder à de tels changements de comportement sans provoquer frustration et tollé face à ce qui prend l’allure d’un « effondrement » de nos modes de vie ? Principal enjeu de la manœuvre : « Réussir à faire de ce concept un horizon désirable pour le plus grand nombre, et souligner ses bénéfices : amélioration de la santé, du cadre de vie, diminution de la pollution… ». Ce qu’Éloi Laurent, membre de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), traduit en ces termes : « Nous devons apprendre à vivre mieux, pas à vivre moins. Apprendre à vivre avec la biosphère, pas contre elle. »
Volet 2 : repenser nos modes de transport.
S’agissant de réduire l’impact d’un secteur dont on sait qu’il est le seul à avoir augmenté ses émissions de CO2 par rapport à 1990, le chercheur français Aurélien Bigo se montre clair : « Il y a cinq leviers pour décarboner la mobilité. La demande de transport, le report modal, le taux de remplissage, l’efficacité énergétique des véhicules et l’intensité carbone de l’énergie. Les trois premiers relèvent de la sobriété, les deux derniers jouent plutôt sur la technologie. Or, la stratégie nationale bas carbone, mise à jour en 2017 et visant à arriver à zéro émission en 2050, prévoit surtout d’agir sur les leviers technologiques ». Par conséquent, ici encore, la « sobriété » s’impose. Toutefois, dans l’esprit des usagers, un tel impératif reste surtout perçu comme un intolérable facteur de restrictions. De limitations d’usage. À preuve : la révolte des « gilets jaunes » déclenchée par les 80 km/h et un projet de taxation du gazole. Alors, comment faire accepter de limiter la vitesse sur les autoroutes à 110 km/h – une mesure pourtant efficace en matière de décarbonation ? Comment, en outre, rendre attractives les diverses stratégies d’urbanisation prenant en compte les lignes de transports en commun (report modal du véhicule individuel) et la volonté de rendre tant marchables que cyclables les espaces peu denses… sachant leurs conséquences économiques à moyen terme sur l’industrie automobile ? Ou comment faire passer, au moyen d’un report massif sur le train, les limitations des déplacements en avion, face à la montée en puissance des compagnies à bas coûts ? – soit celles qui volent le plus… donc les plus polluantes ?
Volet 3 : notre système alimentaire.
Système devenu intenable à cause de son impact sur le climat. Du fait que notre chaîne alimentaire pèse un quart des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine. Que l’agriculture (et notamment les grandes monocultures nourries aux intrants) constitue un des facteurs reconnus de perte de la biodiversité et de dégradation des terres. Qu’à lui seul, l’élevage pèse la moitié des émissions du secteur agricole et 14,5% des émissions totales d’origine humaine. Ici donc de nouveau la « sobriété » s’impose, qui implique la transformation du contenu de nos assiettes et de nos modes de production. Dans ce contexte, réduire la part de l’alimentation consacrée à la viande dans les pays développés est devenu indispensable. Mais comment faire accepter par le consommateur une transition devenue impérative (et en outre bien plus saine !) quand celle-ci semble faire fi du prétendu « libre choix » de chacun ? Et que, surtout, « les contraintes pesant sur les ménages – du prix des denrées au temps consacré à la préparation des repas – incitent à aller vers les aliments transformés moins chers » ? Comment, en outre, amener les producteurs à réduire leurs cheptels, sachant que « plus on monte dans les étages des instances politiques et syndicales, moins le discours est ouvert à ces questions » (Christian Couturier) ?
Volet 4 : la frénésie d’achats.
Surtout centré sur l’Hexagone, l’état des lieux d’une surconsommation exacerbée par la publicité (y compris à grands coups de marketing ciblé et d’algorithmes sur Internet) a de quoi faire se questionner l’ensemble des sociétés occidentales. Car où trouver la force de s’opposer à pareil « pousse-au-crime » généralisé – au reste loué par divers spécialistes de la consommation, ainsi Patrice Duchemin qui n’hésite pas à déclarer : « La consommation, c’est du plaisir et du “pour soi”, c’est le meilleur antidépresseur. C’est aussi une manière de dire que l’on appartient à la société ». D’entre les addictions citées, l’une suffit à édifier, qui émane de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) : « Si les Français pensent posséder 34 appareils électriques et électroniques par foyer, ils en détiennent, en réalité, 99 en moyenne, dont 6 jamais utilisés. Entre 54 millions de 110 millions de smartphones dorment dans les tiroirs et 2,5 tonnes d’objets en moyenne sont accumulés dans les logements, soit 45 tonnes de matières mobilisées pour les fabriquer ». À partir de là, songeant que la population mondiale devrait atteindre 10 milliards de personnes d’ici à 2050, il est facile de réaliser que nos modes de production et de consommation ne sont plus soutenables. Or il se trouve que pratiquement aucun domaine n’échappe aux dictats de la Croissance… fût-ce au moyen d’une obsolescence habilement programmée. Conscientes des conséquences de ce débridement mercantile, des structures se proposant de mutualiser tout ce qui peut avoir une utilisation rare ou ponctuelle se multiplient. Mais pour ce qui échappe au domaine des outils et appareils utilitaires ? « Ne pas consommer ou réduire sa consommation est un choix politique qu’il est parfois difficile d’assumer à un niveau individuel ».
Volet 5 : Aménagement du territoire et techniques de construction.
Autre secteur visé pour être à l’origine de près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre, lui non plus ne saurait être laissé à l’arbitraire des promoteurs. Faire moins. Différemment. Cesser de construire des bâtiments neufs tant qu’on n’a pas fini d’occuper les vides… autant d’injonctions reprises aux plus hauts niveaux. Ainsi Raphaël Ménard lançant, lors d’une rencontre avec deux sénateurs de la commission des affaires européennes : « Qu’est-ce qui nous prouve qu’on a encore besoin de construire du neuf ? » Christine Leconte, présidente du Conseil national de l’ordre des architectes, n’assure-t-elle pas : « On recense de 2 millions à 3 millions de logements vacants, dont 600 000 à 700 000 dans les villes moyennes. Six cent mille, c’est l’équivalent de deux années de constructions neuves ». De quoi secouer un secteur du bâtiment qui a pris du retard sur les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Au total, il va s’agir de : transformer les logements vacants et les résidences secondaires en résidences principales ; diminuer drastiquement le nombre de constructions neuves ; privilégier l’appartement sur la maison ; réduire de 30% la taille des maisons individuelles ; privilégier le bois, la terre, la pierre, la taille, plutôt que le béton ; recycler divers matériaux (en Belgique, on réutilise les anciennes briques) ; mettre fin à l’usage du carrelage dans les salles de bain ; abaisser les températures de confort, etc. De quoi nous rendre hostile le futur ? Tout au contraire – du moins selon The Shift Project, un groupe de réflexion sur la décarbonation de l’économie, pour qui les logements de 2050 seront plus confortables, plus sains, moins humides et moins froids en hiver, frais les jours de fortes chaleurs.
En conclusion, seule issue à l’impasse aux multiples visages : l’urgence d’un véritable débat public. Faute de quoi, prévient l’éditorial du Monde du 31 mai, « le risque est grand que la sobriété finisse par s’imposer brutalement au lieu d’être choisie avec tous les risques de tension sociale et de violence que cela entraîne ».
 État d'urgence Ce qu'en dit la science
État d'urgence Ce qu'en dit la science