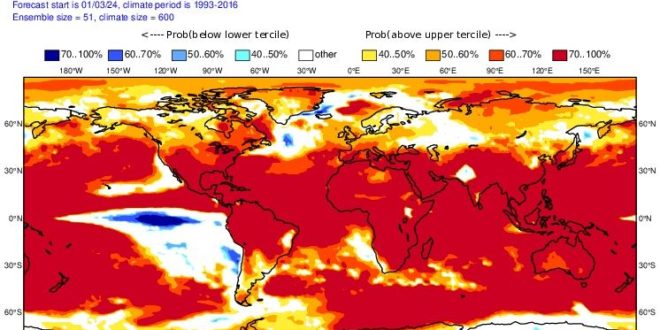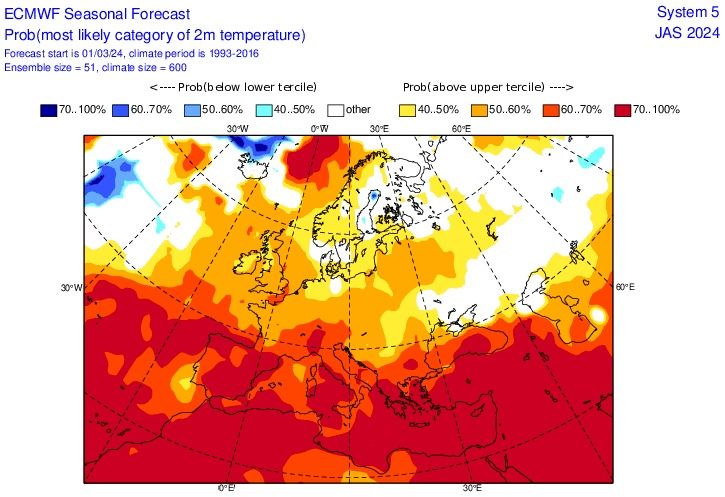Le Temps, 10 mai 2024
Avec l’usine islandaise Mammoth, la start-up suisse Climeworks a passé la seconde
L’article présente les efforts de Climeworks, une start-up suisse, pour capturer le dioxyde de carbone (CO2) de l’air et le stocker de manière durable afin de lutter contre le réchauffement climatique. La société a inauguré la plus grande usine au monde de captage de CO2 en Islande, nommée Mammoth, qui vise à capter 36 000 tonnes de CO2 par an en utilisant 72 conteneurs de ventilateurs. Cette usine fonctionne grâce à l’énergie géothermique fournie par la centrale de Hellisheidi. Le CO2 capturé est dissous dans de l’eau et injecté dans le sous-sol basaltique, où il réagit avec les minéraux pour former des cristaux solides, servant de réservoirs stables de CO2.
Climeworks ambitionne de réduire le coût de captage du CO2 de 1000 dollars à 300 dollars par tonne d’ici 2030 et prévoit une expansion mondiale, avec un objectif de capturer des millions de tonnes de CO2 par an d’ici 2030, et jusqu’à un milliard d’ici 2050. Toutefois, la technologie est coûteuse et dépend de la disponibilité d’énergie renouvelable. Elle est donc considérée comme une solution complémentaire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par d’autres moyens.
L’article mentionne également des critiques concernant cette technologie, notamment le risque de fournir un « permis de polluer » aux entreprises tout en détournant des investissements qui pourraient être mieux utilisés pour développer des solutions telles que les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Cependant, Climeworks et ses partenaires, comme Carbfix, continuent d’innover, explorant par exemple l’utilisation de l’eau de mer pour le stockage du CO2, afin de rendre le processus plus accessible et applicable à l’échelle mondiale.
Autres considérations
État d’urgence 4 septembre 2024
Le coût
L’un des principaux défis de la capture et du stockage du carbone (CCS) réside dans les coûts énergétiques élevés et la complexité de créer et d’exploiter des sites d’injection de CO₂ fiables. L’ajout d’une technologie CCS à une centrale électrique au charbon ou au gaz naturel engendre un coût supplémentaire important (Mammoth fonctionne grâce à l’énergie géothermique fournie par la centrale de Hellisheidi), nécessitant une part considérable de l’énergie produite pour alimenter le processus de capture et de stockage. En général, on estime que ce processus peut absorber environ 20 à 25 % de l’électricité produite par la centrale, bien que ce chiffre puisse varier en fonction de l’efficacité de la technologie utilisée. Un tel coût additionnel, tant en énergie qu’en dépenses financières, réduit la compétitivité de l’électricité produite à partir de combustibles fossiles par rapport aux énergies renouvelables, comme le solaire et l’éolien, qui ne nécessitent pas de stockage de carbone.
En termes de retour sur investissement énergétique (EROI, Energy Return On Investment), les énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien, même avec stockage, affichent un EROI d’environ 15 à 20. En comparaison, l’EROI initial de l’électricité produite à partir de combustibles fossiles est généralement autour de 30. Cependant, lorsqu’on soustrait environ 25 % de ce rendement énergétique pour intégrer la CCS, l’EROI chute à environ 22. Ce calcul simplifié ne prend pas en compte l’énergie supplémentaire nécessaire à la fabrication des équipements de capture, de pressurisation et d’injection du CO₂, ce qui pourrait réduire encore davantage l’EROI. En fin de compte, ces coûts énergétiques et financiers considérables limitent l’attractivité de la CCS, surtout face aux énergies renouvelables dont les coûts continuent de baisser et qui bénéficient d’un EROI plus favorable.
Émissions CO2
En 2021, les émissions mondiales de CO₂ dues aux activités humaines étaient estimées à environ 36,3 milliards de tonnes (36,3 gigatonnes). Pour capturer l’intégralité de ces émissions à l’aide de la technologie CCS, il faudrait un nombre considérable d’installations de captage et de stockage de carbone, chacune ayant une capacité de capturer des millions de tonnes par an. En supposant que chaque installation puisse capturer 1 million de tonnes de CO₂ par an, il faudrait environ 36’300 installations de ce type pour traiter l’ensemble des émissions mondiales (actuellement 36’000 tonnes par an, donc 1’008’333 installations). En plus du nombre élevé d’installations nécessaires, il faudrait également trouver un grand nombre de sites de sous-sol géologiquement fiables (1) pour injecter et stocker en toute sécurité le CO₂ capturé. Cela représente un défi logistique et technique immense, nécessitant des investissements massifs et une évaluation minutieuse des ressources géologiques disponibles dans le monde entier.
- Le stockage du CO₂ nécessite des formations géologiques spécifiques, comme des aquifères salins profonds ou des champs pétroliers épuisés, qui sont capables de retenir le CO₂ en toute sécurité sur de longues périodes. Trouver et évaluer ces sites de stockage constitue un défi majeur, d’autant plus qu’ils doivent être géologiquement stables et situés à une distance raisonnable des installations de captage pour minimiser les coûts de transport.
Surface du site Mammoth ?
La construction et l’entretien des installations de captage et de stockage du carbone (CCS) comme le site de Mammoth ne sont pas sans impact environnemental. Selon l’outil de mesure de Google Earth, la surface du site de Mammoth est d’environ 41 000 m² (valeurs approximatives du site complet supposé. Environ six terrains de football). Construire une telle infrastructure nécessite une quantité considérable de matériaux, dont des tonnes de béton et dimportante structures métalliques, ce qui génère une pollution non négligeable en raison de l’extraction, du transport, et de la mise en œuvre de ces matériaux.
Le béton, indispensable dans la construction, est un matériau dont la production est énergivore et contribue aux émissions de CO₂. On estime qu’une tonne de béton produit environ 100 à 300 kg de CO₂, principalement en raison du ciment qu’il contient, dont la fabrication est particulièrement polluante. Pour une infrastructure de grande taille, comme le site de Mammoth, la quantité de béton utilisée entraîne un coût environnemental notable. En outre, les structures métalliques nécessaires à ce type d’installation, comme les charpentes et les supports, exigent également une énergie considérable pour leur production et leur maintenance, générant des émissions supplémentaires. L’entretien régulier de l’installation implique des dépenses énergétiques continues, non seulement pour la maintenance des équipements, mais aussi pour la gestion et la préservation des infrastructures, augmentant encore l’empreinte carbone globale du projet.
Pour donner une estimation approximative, si l’on suppose que la construction et l’entretien du site de Mammoth nécessitent des milliers de tonnes de béton et d’autres matériaux, les émissions de CO₂ associées pourraient représenter plusieurs milliers de tonnes, sans compter l’énergie consommée pendant la durée de vie de l’installation. En effet, les coûts énergétiques et financiers de l’entretien régulier d’un site de 41 000 m², combinés à la pollution générée par les matériaux de construction, montrent que même les solutions de captage de CO₂ ont des impacts environnementaux qui doivent être soigneusement évalués et minimisés pour être vraiment bénéfiques dans la lutte contre le changement climatique. C’est un aspect souvent sous-estimé mais crucial pour évaluer l’efficacité globale des solutions CCS dans la lutte contre le changement climatique.
Sobriété ou technosolutions : quelle voie suivre ?
Ne serait-il pas préférable de repenser notre approche face au changement climatique en privilégiant des mesures de réduction de la consommation à grande échelle plutôt que de compter sur des technosolutions coûteuses et incertaines comme le captage et le stockage du carbone (CCS) ? En effet, la sobriété volontaire, adoptée par toutes et tous, constitue une méthode plus efficace et socialement équitable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce que l’on ne consomme pas n’émet pas de CO₂, à condition que les objets ou dépenses inutiles ne soient pas remplacés par d’autres achats. Cette approche simple et directe peut conduire à des résultats immédiats et tangibles dans la lutte contre le changement climatique.
Les technologies comme le captage et le stockage du carbone (CCS), malgré leurs promesses, ne constituent pas des solutions durables à long terme. Elles nécessitent des investissements financiers très importants et dépendent de ressources naturelles spécifiques, dans le contexte d’une planète aux capacités limitées. Continuer à investir massivement dans ces solutions technologiques, sans évaluer leurs limites et leur coût environnemental, pourrait s’avérer contre-productif. Plutôt que de se reposer sur des technologies dont l’efficacité et la viabilité restent incertaines, il semble plus judicieux de se concentrer sur des actions visant à réduire directement notre empreinte écologique.
Réduire drastiquement la consommation, en particulier dans les pays riches, est une alternative plus durable et plus équitable. Une diminution significative de la consommation d’énergie et de ressources par les pays occidentaux, accompagnée d’une redistribution plus équitable des biens, permettrait de créer un modèle de sobriété que les pays moins favorisés pourraient suivre. Cela contribuerait non seulement à réduire les émissions globales de CO₂, mais également à promouvoir un développement mondial plus juste et soutenable, loin du modèle actuel de surconsommation des pays riches.
Il est temps de « prendre le taureau par les cornes » et d’adopter des solutions concrètes basées sur la réduction de la demande. Les gouvernements doivent se responsabiliser et mettre en place des mesures contraignantes et socialement justes pour encourager une consommation plus sobre. Des politiques de programmes éducatifs pour sensibiliser le public à l’importance de la réduction de leur empreinte carbone sont des actions nécessaires.
Plutôt que de compter sur des technosolutions hasardeuses, il est crucial de se tourner vers des stratégies plus sûres, justes et durables, qui favorisent une véritable transformation de nos modes de vie et de consommation. La réduction de la consommation n’est pas seulement une nécessité environnementale, mais aussi un choix éthique pour assurer une répartition équitable des ressources et protéger les générations futures.
Utopie ?
Non, adopter la sobriété et réduire notre consommation est une voie réaliste et nécessaire. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cela ne signifie pas renoncer au confort ou à la qualité de vie, mais plutôt réévaluer nos priorités et adopter des modes de vie plus soutenables. En favorisant des pratiques de consommation responsables, nous pouvons non seulement réduire notre empreinte carbone, mais aussi stimuler des économies locales, renforcer les communautés et améliorer notre résilience face aux crises futures. En somme, cette approche offre des avantages économiques, sociaux et environnementaux, prouvant qu’un avenir plus sobre est non seulement possible, mais aussi désirable.
La Suisse enterre son CO2…
« La Suisse a entrepris un projet pilote en collaboration avec l’EPFZ pour capturer et exporter une petite fraction de son CO2 vers l’Islande. Bien que la RTS présente ce projet comme une solution prometteuse, la réalité est bien différente. Avec toutes les pertes liées au captage, à la liquéfaction, au transport, à la dissolution dans l’eau de mer et à l’injection à 400m de profondeur (sans oublier les fuites potentielles), le bilan écologique réel est loin des chiffres annoncés. Sur les 300 tonnes captées, soit l’équivalent des émissions annuelles de 30 Suisses, il ne reste finalement de quoi ‘neutraliser’ les émissions d’environ 15 à 20 personnes.
En présentant ce type de projet de manière positive, les médias contribuent à tranquilliser la population, qui minimise ainsi l’ampleur de la catastrophe climatique en cours. Cela alimente l’idée fausse que des solutions technologiques non réalistes pourront nous sauver, alors qu’elles ne s’attaquent qu’à une infime partie du problème. Plus de détails dans cet article de la RTS : La Suisse enterre son CO2 en Islande. »
Décarbonation industrielle ? :
Cet article rédigé par Pascal Kotté aborde différentes initiatives et technologies visant à capturer le CO2 pour lutter contre le changement climatique, tout en s’interrogeant sur leur efficacité par rapport à des méthodes naturelles comme la plantation d’arbres. Il mentionne des projets comme Climeworks en Suisse et Project Vesta, qui utilisent des machines pour capturer le CO2, mais soulève des doutes quant à leur coût élevé et leur efficacité à long terme.
Il évoque également les défis de la capture et du stockage du carbone (CSC), expliquant que bien que des projets existent, ils ne sont pas encore suffisamment aboutis ou largement déployés pour avoir un impact significatif. L’auteur compare ces technologies aux processus naturels comme la photosynthèse, en soulignant l’importance des arbres pour capter le carbone, mais critique également l’idée que planter des arbres soit une solution complète au problème des émissions de CO2.
En conclusion, il exprime un certain scepticisme face à l’optimisme entourant les nouvelles technologies de capture du CO2, insistant sur le fait que la réduction de la consommation d’énergie fossile reste la priorité. Il critique également l’approche de compensation carbone comme étant insuffisante et plaide pour une approche plus responsable des entreprises et des gouvernements en matière de réduction des émissions.
Compléments
-
- www.encyclopedie-energie.org/captage-et-stockage-du-carbone/ (2016)
- L’erreur fondamentale de la transition énergétique (Vincent Mignerot, Lausanne en décembre 2022, lors de la journée annuelle des Shifters Switzerland).
- Sobriété possible : www.latelierpaysan.org/
 État d'urgence Ce qu'en dit la science
État d'urgence Ce qu'en dit la science