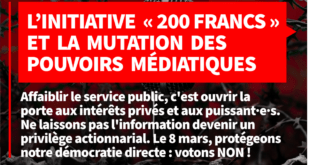Table des matières
Dernière modification le 26-11-2025 à 23:22:10
Pas de solutions ?
En regardant le récent reportage de la RTS sur le travail frontalier à Genève, j’ai été frappé par un passage vers la fin de la vidéo : après avoir décrit en détail les embouteillages, les inégalités et les tensions de part et d’autre de la frontière, l’idée qui ressort est une forme d’impuissance – comme si, en résumé, « il n’y avait pas de solution » : le reportage RTS.
Pour un village comme Soral, situé en première ligne du trafic de transit, cette impression est compréhensible. Mais elle est dangereuse. Car elle laisse croire que la seule alternative serait de subir – ou de se résigner à de nouveaux projets routiers massifs, comme l’élargissement des autoroutes ou des contournements très coûteux, qui déplacent les problèmes sans les résoudre : soral.ch
Or la solution existe, à condition d’un peu de volonté politique… et de médias qui acceptent de parler des scénarios alternatifs. C’est précisément ce que je propose d’esquisser ici, en écho à une chronique que j’ai consacrée à une alternative à l’élargissement des autoroute : État d’urgence.
Soral, village en première ligne du trafic frontalier
Soral n’est pas un symbole abstrait : c’est un petit village genevois, traversé quotidiennement par un trafic de transit disproportionné par rapport à sa taille, en grande partie lié aux déplacements frontaliers : soral.ch
Depuis des années, les habitant·e·s dénoncent le bruit, la pollution, l’insécurité routière, la difficulté à traverser le village à pied ou à vélo. Un projet de contournement évalué à plusieurs dizaines de millions de francs a été mis sur la table pour tenter de détourner une partie du flux :
Tribune de Genève / ge.ch
Mais ce type de réponse est pris dans un paradoxe :
- d’un côté, on reconnaît que le trafic est déjà trop élevé pour un village comme Soral ;
- de l’autre, on continue à penser la mobilité en ajoutant des voies, des contournements, des capacités routières, ce qui finit immanquablement par attirer davantage de voitures (effet bien documenté d’« induction du trafic ») : actif-trafic.ch
Autrement dit, on soigne les symptômes localement sans remettre en cause la logique globale qui les produit.
Le réflexe autoroutier : une fausse solution durable
Partout en Suisse, des projets d’élargissement d’autoroutes sont avancés au nom de la fluidité du trafic, de la sécurité et de la compétitivité économique. C’est le cas notamment sur l’A1, par exemple entre Le Vengeron et Nyon ou sur d’autres tronçons déjà engagés : efk.admin.ch / regiondenyon.ch / strasseschweiz.ch
Le problème, du point de vue climatique comme du point de vue de la qualité de vie actif-trafi.ch :
Élargir attire plus de trafic : une fois la capacité augmentée, le trafic croît jusqu’à saturer à nouveau l’infrastructure. Les embouteillages se déplacent et reviennent.
Les émissions de CO₂ augmentent, alors que la Suisse s’est engagée à réduire rapidement ses émissions et à atteindre la neutralité climatique. Les transports sont l’un des principaux postes d’émissions.
Les villages et quartiers en bout de chaîne subissent les nuisances, même si les autoroutes sont « modernisées » ou entourées de murs antibruit : bruit, pollution, danger pour les piéton·ne·s, fragmentation des territoires.
Dans ce contexte, continuer à répondre par des « méga-autoroutes » ou des contournements massifs, sans réduire la dépendance à la voiture individuelle, revient à gérer une fuite d’eau en augmentant le diamètre du tuyau – au lieu de fermer le robinet.
La solution existe : réorganiser la mobilité plutôt qu’élargir les routes
Dans une chronique publiée sur etatdurgence.ch, j’ai proposé une alternative à l’élargissement des autoroutes, pensée dès 2015 et encore plus pertinente aujourd’hui.
L’idée de base est simple : utiliser l’infrastructure routière existante pour mettre en place un système de mobilité collective, efficace, qui réduit drastiquement la place de la voiture individuelle : État d’urgence
Des stations de bus aux entrées des autoroutes
Plutôt que d’élargir les autoroutes, on pourrait créer de grandes stations de bus électriques aux entrées des axes principaux. Les automobilistes y laissent leur voiture sur des parkings adaptés, puis montent dans des bus rapides, réguliers, qui desservent les principaux pôles d’emploi et les centres urbains.
- moins de voitures sur les tronçons sensibles.
- moins de pression sur les villages traversés.
- moins de béton à couler, donc moins d’émissions liées à la construction.
Un maillage fin de bus plus légers
À la place de quelques bus lourds et peu fréquents, on déploie un réseau de bus plus petits et plus légers, plus fréquents, qui desservent finement les quartiers et villages, avec des correspondances optimisées vers les stations principales.
Ces bus :
- abîment moins les routes,
- s’insèrent mieux dans les traversées de village,
- permettent une cadence élevée, donc une vraie alternative à la voiture.
Des bus à la demande pour les zones rurales
Pour les villages comme Soral et les zones rurales alentours, un système de bus à la demande (ou à cadence régulière, mais fine) relierait les habitant·e·s aux stations de bus principales, sans nécessiter des infrastructures nouvelles. Les routes existent déjà : on change le service, pas le bitume.
Vélos électriques et petits véhicules partagés
Aux grandes stations et aux points de correspondance, on développe massivement :
- des vélos électriques et vélos cargo en libre-service,
- de petits véhicules partagés pour les personnes qui ne peuvent pas pédaler,
- des solutions spécifiques pour les personnes à mobilité réduite.
Cela permet de couvrir « le dernier kilomètre » sans multiplier les voitures individuelles ni agrandir encore les routes.
Une logistique repensée pour livraisons et déménagements
Dans ce scénario, une partie des camions et véhicules utilitaires qui encombrent aujourd’hui les villages serait remplacée par :
- des services de livraisons mutualisées,
- des solutions de déménagement et transport local gérées par des opérateurs dédiés, adaptés à un maillage plus fin et à des véhicules plus légers.
On réduit ainsi les nuisances, tout en gardant un accès aux services essentiels.
Relocaliser une partie de l’économie pour réduire les déplacements
Enfin, cette vision de la mobilité va de pair avec une autre évidence souvent oubliée : plus les services de base sont proches, moins on est obligé de se déplacer.
Une politique active d’épiceries, de commerces, de services de proximité, de lieux de travail partagés (coworking) dans les villages peut réduire fortement les trajets pendulaires et la dépendance quotidienne à la voiture.
Et pour Soral, concrètement ?
Appliquée au cas de Soral et du Grand Genève, une telle approche pourrait se traduire par :
- Limiter clairement le trafic de transit non indispensable dans la traversée du village, en définissant des axes prioritaires pour le trafic frontalier et des axes à protéger, comme l’évoquent déjà certains documents politiques : ge.ch
- Créer des points de rabattement vers les transports collectifs en amont des villages, plutôt que de laisser les voitures pénétrer partout.
- Offrir des alternatives crédibles aux travailleur·euse·s frontalier·e·s : bus rapides, horaires adaptés, parkings-relais attractifs, incitations au covoiturage, télétravail quand il est possible.
- Repenser la desserte locale pour que les habitant·e·s de Soral puissent se rendre au travail, à l’école, aux services sans passer systématiquement par la voiture individuelle.
L’enjeu n’est pas de « sacrifier » Soral pour sauver ailleurs le trafic, ni l’inverse. L’enjeu est de sortir d’une logique où chaque commune tente de repousser les nuisances chez la voisine, pendant que les grands projets autoroutiers continuent de gonfler le volume de trafic global.
Médias, volonté politique et imagination collective
Quand un responsable politique dit en substance « on ne voit pas de solution », ce n’est pas neutre. Cela façonne l’imaginaire collectif. On finit par croire que l’augmentation sans fin du trafic est une fatalité, et que la seule marge de manœuvre serait de rajouter des voies, des contournements, des échangeurs.
Or la transition climatique et la justice sociale exigent exactement l’inverse :
- sortir de la dépendance au trafic routier,
- réduire les inégalités d’exposition aux nuisances,
- offrir des alternatives concrètes et accessibles à toutes et tous, y compris aux travailleur·euse·s frontalier·e·s qui n’ont souvent pas choisi la configuration actuelle de l’urbanisme et de l’emploi.
Les médias ont un rôle clé : montrer des pistes, donner la parole à celles et ceux qui proposent des scénarios différents, documenter les expériences réussies ailleurs plutôt que de s’arrêter au constat d’impuissance.
Conclusion : sortir de la fausse évidence « il n’y a pas de solution »
Non, Soral n’est pas condamné à subir éternellement le trafic frontalier dans sa forme actuelle. Non, le Grand Genève n’est pas condamné à choisir entre embouteillages quotidiens et méga-autoroutes climatiquement intenables.
La solution existe, mais elle suppose trois choses :
- changer de logique, en passant de l’élargissement des routes à la réorganisation de la mobilité ;
- assumer l’urgence climatique et la justice sociale comme critères centraux d’aménagement du territoire ;
- mobiliser la créativité politique, technique et citoyenne, plutôt que de répéter que « l’on ne voit pas d’alternative ».
Cet article n’est pas un plan détaillé clé en main. C’est une invitation. Invitation adressée à la commune de Soral, aux autorités cantonales, aux responsables de la mobilité dans le Grand Genève et aux médias :
- à débattre publiquement de ces alternatives,
- à les confronter à la réalité du terrain,
- à lancer des études et des projets pilotes,
- à faire de Soral et des villages similaires des laboratoires de solutions, plutôt que des victimes collatérales du tout-voiture.
Il est temps que le débat sur les autoroutes et le trafic frontalier ne se limite plus à la question « élargir ou ne rien faire ».
Entre ces deux impasses, il existe une voie : organiser autrement nos déplacements, pour que la vie soit à nouveau possible et respirable, des deux côtés de la frontière.
Références
Ndr : Les références listées ont été partiellement consultées pour vérifier la cohérence de l’analyse proposée avec l’état actuel des connaissances scientifiques. Une lecture exhaustive excéderait le cadre de cet article, elles sont donc fournies comme ressources complémentaires permettant au lecteur ou à la lectrice d’approfondir les thématiques abordées.
Ce que montrent les études
Trafic induit confirmé : élargir les routes n’enlève pas les embouteillages — cela crée simplement plus de circulation. (Duranton & Turner 2011 ; Hymel 2019 ; revue DfT 2018)
Sources :
www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.101.6.2616
ideas.repec.org/a/eee/trapol/v76y2019icp57-66.html
assets.publishing.service.gov.uk/media/5c0e5848e5274a0bf3cbe124/latest-evidence-on-induced-travel-demand-an-evidence-review.pdf
Réduction du CO₂ par report modal : recourir aux transports publics électriques, au rail, au vélo ou à la marche réduit fortement les émissions par passager-km. (IPCCLe GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) est une organisation qui a été mise en place en 1988, à la demande du G7 (groupe des 7 pays les plus riches : USA, Japon, Allemagne, France, Grande Bretagne, Canada, Italie). La version anglaise de cet acronyme est IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change). AR6Sixième rapport d’évaluation du GIEC : Sixième cycle complet d’évaluation scientifique publié par le GIEC (2021–2023). Comprend les rapports des trois groupes de travail et la synthèse globale.
Référence mondiale sur le climat. WGIII ; IEAInternational Energy Agency / Agence internationale de l’énergie : Organisme intergouvernemental qui analyse les systèmes énergétiques mondiaux. Produit des rapports de référence sur la transition énergétique et les émissions.)
Sources :
www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_FOD_Chapter10.pdf
www.iea.org/reports/the-future-of-rail
Alternatives crédibles et efficaces : réseaux combi (bus, rail, P+R, vélo, transport partagé) peuvent absorber une grande partie du trafic automobile, à des coûts souvent inférieurs à ceux des autoroutes. (rapports IEA, synthèses UITP/transport public, VTPI)
Sources :
www.iea.org/reports/the-future-of-rail
www.vtpi.org/gentraf.pdf
Bibliographie structurée
Duranton, Gilles & Turner, Matthew A. (2011). « The Fundamental Law of Road Congestion: Evidence from US Cities ». American Economic Review, 101(6), 2616–2652. DOI : 10.1257/aer.101.6.2616
Texte :
www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.101.6.2616
PDF (version de travail) :
repository.upenn.edu/bitstreams/0bcfec7a-fb82-4d8c-b838-18cbb299e116/download
Hymel, Kent (2019). « If you build it, they will drive: Measuring induced demand for vehicle travel in urban areas ». Transport Policy, 76, 57–66. DOI : 10.1016/j.tranpol.2018.12.006
Texte :
ideas.repec.org/a/eee/trapol/v76y2019icp57-66.html
UK Department for Transport (DfT) / WSP & RAND Europe (2018). « Latest evidence on induced travel demand: an evidence review ». Rapport.
PDF :
assets.publishing.service.gov.uk/media/5c0e5848e5274a0bf3cbe124/latest-evidence-on-induced-travel-demand-an-evidence-review.pdf
International Energy Agency (IEA) (2019). « The Future of Rail ». Rapport, 2019.
Texte :
www.iea.org/reports/the-future-of-rail
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2022). « AR6 WGIII – Chapitre 10 “Transport” ». Rapport.
PDF :
www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_FOD_Chapter10.pdf
Victoria Transport Policy Institute (VTPI) (mise à jour 2025). « Generated Traffic and Induced Travel: Implications for Transport Planning ». Rapport en ligne.
PDF :
www.vtpi.org/gentraf.pdf
 État d'urgence Ce qu'en dit la science
État d'urgence Ce qu'en dit la science