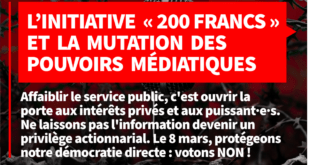Table des matières
Dernière modification le 26-11-2025 à 14:01:49
Une décision historique, un réflexe de peur prévisible
Le vote du Grand Conseil vaudois marque un tournant majeur : selon l’article publié ce 25 novembre par 24 heures « La fin du chauffage fossile a sonné dans le canton de Vaud », le canton engage enfin la sortie progressive du mazout, du gaz et du charbon dans le bâtiment. Les nouvelles constructions devront renoncer immédiatement aux chauffages fossiles, et les installations existantes seront remplacées dans un délai de quinze à vingt ans. Un choix clair, cohérent avec l’urgence climatique : 38% des émissions cantonales proviennent encore du chauffage fossile, comme le rappelle le conseiller d’État Vassilis Venizelos.
Cette réforme n’est pourtant pas garantie. L’UDC annonce déjà un référendum, en s’appuyant sur les ressorts habituels : la peur, l’incertitude et le portefeuille. Le réflexe est systématique : quand une mesure climatique fondée sur des données factuelles arrive au Parlement, la résistance s’organise autour d’un discours anxiogène plutôt que d’un débat sérieux.
Ce contraste est frappant. D’un côté, un fait objectivement documenté : sortir du fossile est indispensable pour stabiliser le climat, réduire les risques sanitaires, renforcer notre autonomie énergétique et éviter des coûts futurs gigantesques. De l’autre, une stratégie politique qui ressasse les mêmes recettes : exagérer les coûts immédiats, ignorer les bénéfices à long terme, minimiser la responsabilité du canton à travers la small-share fallacy, et présenter toute avancée climatique comme une menace pour les ménages.
Une stratégie rhétorique éprouvée : déplacer le débat vers la peur
La prise de position de l’UDC Vaud sur la révision de la Loi sur l’énergie s’appuie sur un mécanisme classique : invoquer la peur financière pour s’opposer à des mesures pourtant basées sur des données factuelles et un consensus scientifique solide.
Le message est simple : « cela va vous coûter trop cher ». C’est reproductible, efficace, mais profondément trompeur. Le climat, pourtant, ne se négocie pas sur la base d’un calcul de quelques dizaines ou centaines de francs. Les coûts du dérèglement dépassent largement ce que ces argumentaires tentent de faire croire.
Le coût immédiat mis en avant pour masquer les coûts réels
L’UDC relaie les estimations de milieux immobiliers annonçant « 2,5 milliards par an » et « 200 à 500 CHF de hausse de loyer mensuelle ». Ces chiffres, sortis de leur contexte, servent à construire une image anxiogène pour le public.
Mais ce raisonnement repose sur trois erreurs majeures :
1. Confusion entre coût à court terme et bénéfices à long terme
Investir dans l’isolation, la rénovation et la sortie du fossile réduit les dépenses énergétiques, renforce l’indépendance du canton et diminue les risques climatiques majeurs. La balance coût/bénéfice ne se mesure jamais sur un an, mais sur plusieurs décennies.
2. Faire croire que « l’urgence climatique » serait un luxe
Toutes les données scientifiques montrent l’inverse : l’inaction coûtera plus cher que l’action. Les dégâts climatiques, l’augmentation des assurances, les pertes agricoles, les canicules meurtrières, l’usure des infrastructures — tout cela représente des milliards réels, annuels et non hypothétiques.
3. Utiliser la « small-share fallacy »
L’UDC affirme que « la consommation fossile d’un an du canton équivaut à 20 minutes de consommation mondiale ». C’est un cas d’école de la small-share fallacy : minimiser sa responsabilité au prétexte que sa part est faible.
Si chaque pays applique ce raisonnement, personne n’agit. C’est une erreur logique, morale et politique. Les émissions s’additionnent, et chaque territoire crée soit un effet d’entraînement positif (innovation, exemplarité, pression politique), soit un effet de blocage.
La peur économique comme outil de retardement
Les sciences sociales l’ont bien démontré : parmi les stratégies de freinage climatique, la plus courante est d’exagérer les coûts de la transition pour semer le doute et retarder l’action. Cette rhétorique joue sur l’émotion, pas sur l’analyse.
Le problème n’est pas que les gens aient peur pour leur budget — c’est légitime.
Le problème est que des partis instrumentalisent cette peur pour discréditer les solutions, sans jamais proposer d’alternatives crédibles pour éviter les dégâts futurs.
Ce que dit la science : ignorer les risques coûte infiniment plus cher
Le consensus scientifique est clair : chaque année de retard augmente l’ampleur des impacts climatiques irréversibles.
Les modèles économiques utilisés par les opposants sont souvent dépassés : ils sous-estiment les « points de bascule », les pertes systémiques et les dégâts indirects.
Un canton qui investit dans l’efficacité énergétique et la sortie du fossile ne se sacrifie pas : il se protège.
Un choix de société, pas un calcul myope
Réduire les mesures climatiques à un débat comptable, c’est passer à côté de la réalité:
- La transition énergétique protège les ménages contre les hausses futures du prix des énergies fossiles.
- Elle améliore la santé publique, donc les coûts de santé.
- Elle réduit la vulnérabilité aux canicules et aux événements extrêmes.
- Elle renforce la cohésion sociale en améliorant les logements les plus mal isolés.
La vraie question n’est pas : « combien ça me coûte maintenant ? »
La vraie question est : « combien ça nous coûtera si nous n’agissons pas ? »
Conclusion — sortir du discours de peur pour entrer dans la réalité
L’argumentaire de l’UDC se fonde sur un réflexe politique ancien : effrayer d’abord, réfléchir ensuite. Mais face au dérèglement climatique, ce réflexe devient un déni organisé de la réalité physique, sociale et économique.
La transition énergétique n’est pas une menace : c’est un bouclier.
La réforme de la Loi sur l’énergie n’est pas une lubie : c’est une nécessité vitale.
Et les faux débats sur le « petit impact du canton » ou le « coût immédiat » ne changent rien au fait que nous vivons déjà les conséquences de décennies d’inaction.
Le rôle de la politique devrait être d’affronter le réel, pas de s’en protéger avec des slogans.
Loyers, justice sociale et solutions concrètes ?
Pourquoi les loyers posent aujourd’hui un problème social aigu
- En Suisse, les loyers ont fortement augmenté depuis deux décennies, alors que les coûts hypothécaires ont souvent baissé — ce qui aurait dû logiquement conduire à une baisse des loyers.
- Selon l’initiative, les locataires paient en moyenne ~360 francs de trop par mois par rapport à ce qui serait un loyer « juste », c’est-à-dire fondé sur les coûts réels plus un rendement raisonnable.
- Cette surcharge pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages, en particulier celles et ceux à revenus modestes ou moyens — fragilisant l’accès à un logement digne, amplifiant les inégalités sociales, et limitant la capacité à investir dans d’autres besoins essentiels (santé, alimentation, épargne, transport, formation…).
Ce que propose l’Initiative sur les loyers pour restaurer l’équité
- Inscrire dans la Constitution le principe selon lequel un loyer ne peut être « abusif » s’il excède les coûts effectifs pour le logement + un rendement raisonnable, ou s’il découle d’un prix d’achat exagéré.
- Instaurer un contrôle des loyers automatique et régulier (ou à la demande du·de la locataire), pour éviter que les loyers ne soient fixés librement par des bailleurs cherchant uniquement le profit.
Effets attendus d’une politique loyers justes
- Retour progressif des loyers à un niveau compatible avec les coûts réels — ce qui diminuerait substantiellement le poids des loyers pour une large majorité des habitant·e·s.
- Frein à la spéculation immobilière : si les rendements locatifs ne sont plus disproportionnés, l’intérêt de l’immobilier comme simple placement chute. Cela permet de réorienter le logement vers un usage social plutôt que financier.
- Meilleur accès au logement pour les ménages modestes ou moyens, réduisant la pression sur le budget et améliorant l’équité sociale.
- Stabilisation du marché locatif : les hausses abusives lors de changements de locataire ou après rénovations deviennent plus difficiles, ce qui protège les locataires de l’éviction ou de la gentrification.
Pourquoi c’est complémentaire aux enjeux climatiques
Rénover des logements pour améliorer l’efficacité énergétique et se passer d’énergies fossiles, comme le propose la réforme de la Loi sur l’énergie, ne doit pas se traduire par des loyers prohibitifs. Une politique de loyers justes garantit que la transition écologique reste socialement équitable, sans sacrifier les plus précaires sur l’autel des investissements ou de la rentabilité.
Références
articles
- 24HEURES du 20 novembre 2025 : www.24heures.ch/vaud-fin-des-chauffages-fossiles-votee-par-le-parlement-580450468305
- UDC proposition de referendum : udc-vaud.ch/loi-sur-lenergie-malgre-une-sensible-amelioration-grace-a-ludc-le-referendum-semble-necessaire/
- Le mazout raffiné à condensation préserve-t-il l’environnement ?
- 38% des émissions cantonales viennent encore du chauffage fossile : www.vd.ch/djes/projet-de-loi-sur-lenergie
loyers
- Les loyers sont trop chers : l’ASLOCA lance une initiative sur les loyers
- initiative-loyers.ch : Oui à la protection contre les loyers abusifs.
- Argumentaire : PDF
- La Constitution est modifiée comme suit.
 État d'urgence Ce qu'en dit la science
État d'urgence Ce qu'en dit la science