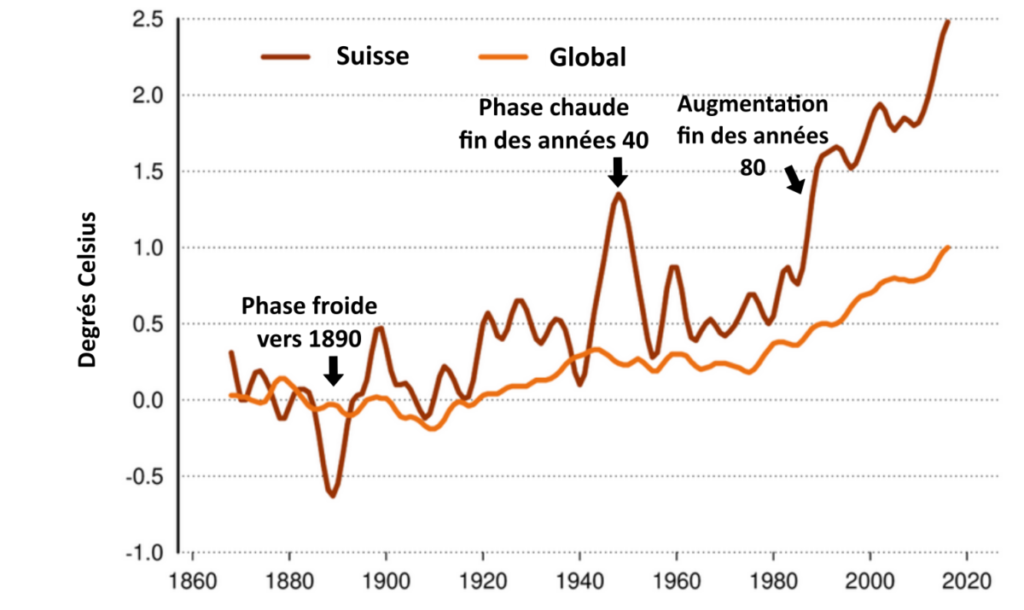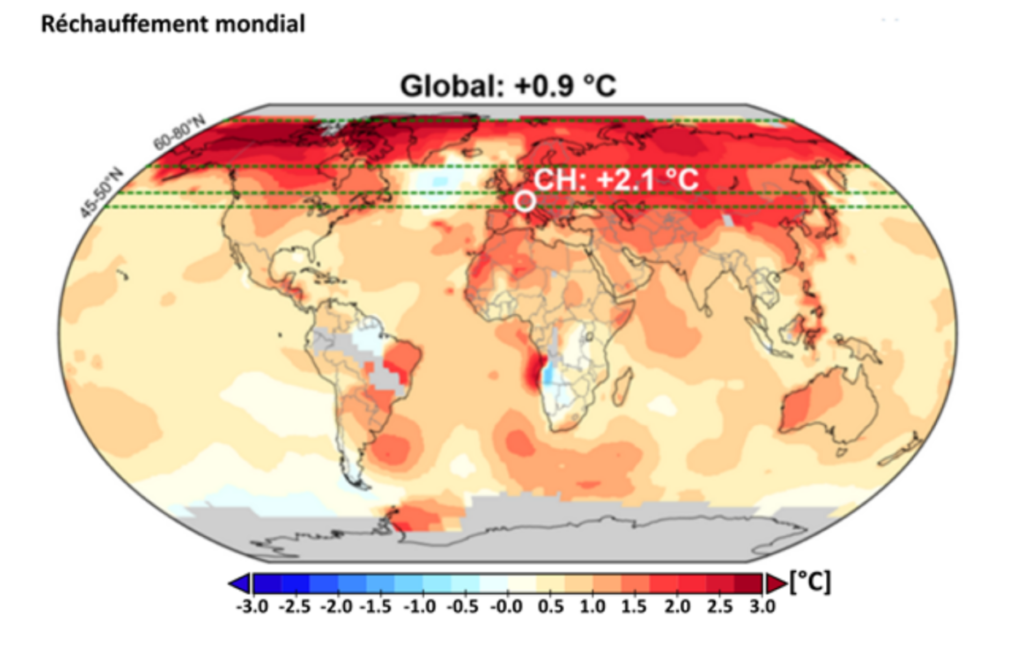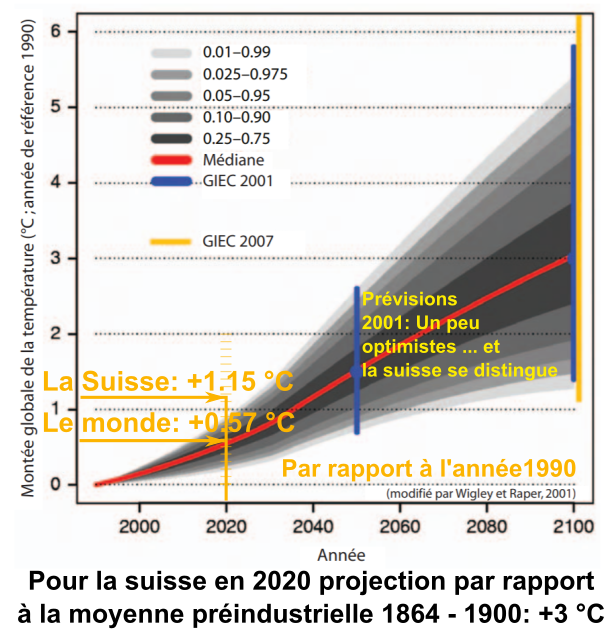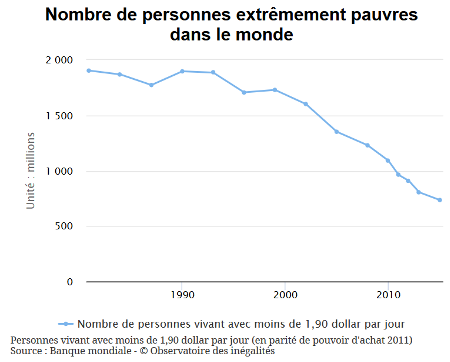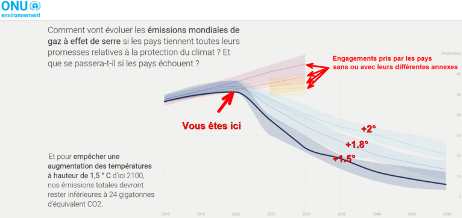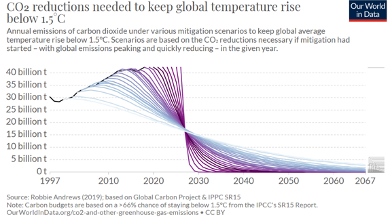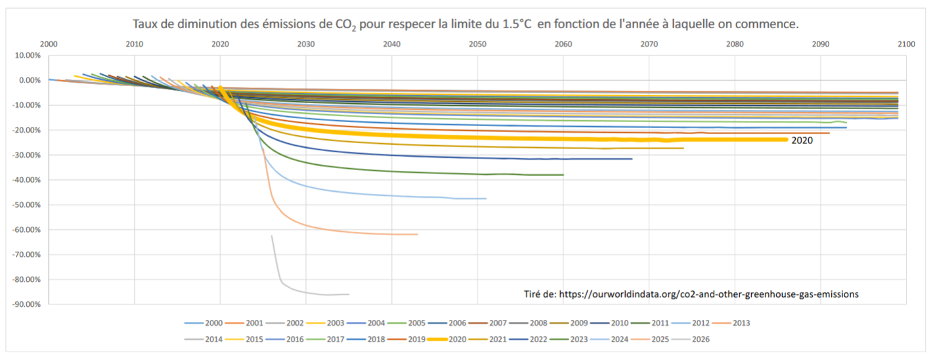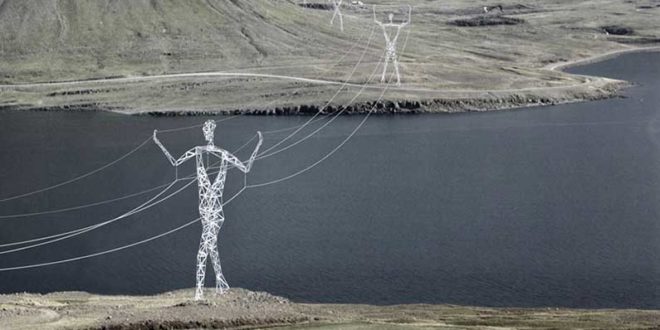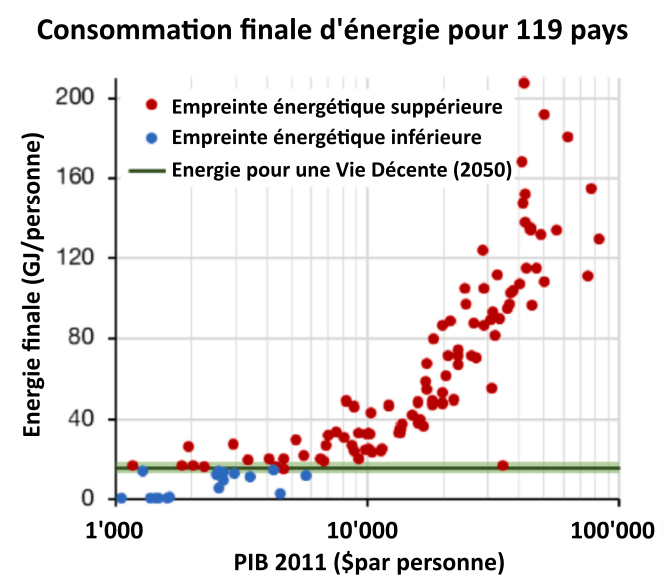Au-delà de 40 000 dollars de PIB par habitant, plusieurs pays semblent s’éloigner volontairement de la viande, selon une nouvelle analyse.
Par Emma Bryce
10 décembre 2021 / source : anthropocenemagazine.org
La consommation de viande augmente à l’échelle mondiale. Mais une poignée de pays se démarquent de cette tendance, et leur appétit pour la viande est en baisse. Un groupe de chercheurs affirme que ces nations – la Nouvelle-Zélande, le Canada et la Suisse – ont en fait atteint le « pic de viande », un point au-delà duquel l’augmentation des revenus ne correspond plus à l’augmentation de la consommation de bœuf, de poulet, de mouton et de porc.
Il pourrait s’agir d’une découverte importante, car la réduction de la consommation de viande est reconnue comme un moyen essentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre. À la lumière de ce constat, le groupe de chercheurs australiens était curieux de voir comment les tendances de la consommation ont évolué entre 2000 et 2019, ce qui couvre une période de sensibilisation croissante à l’impact de la viande sur la planète, mais aussi une période où ces impacts environnementaux se sont intensifiés. Ils ont examiné les niveaux de consommation de viande dans 35 pays au cours de cette période, et les ont combinés avec des informations sur le produit intérieur brut (PIB), une mesure de la taille et de la santé de l’économie d’un pays.
Sans surprise, leur analyse a révélé que la consommation de viande a augmenté dans le monde entier au cours de cette période, les gens consommant en moyenne 4,5 kilos de viande de plus en 2019 qu’en 2000. Mais ces résultats contiennent également des informations inattendues, notamment sur la composition de ce régime alimentaire.
Les données montrent que dans la plupart des 35 pays de l’échantillon, la consommation de bœuf, de porc et de mouton est en fait en baisse. En revanche, la consommation de poulet a augmenté de manière significative dans presque tous les pays étudiés. L’appétit pour le poulet a été particulièrement prononcé en Russie, en Malaisie et au Pérou, où la consommation a augmenté de 20 kilos par habitant au cours de la période de 19 ans.
Cela suggère que le poulet est le principal moteur de l’augmentation de la consommation de viande dans le monde, ce qui, selon les chercheurs, pourrait être dû à la plus grande efficacité avec laquelle ces oiseaux transforment les céréales en protéines. Toutefois, ce boom du poulet s’accompagne également d’une menace croissante de maladies aviaires, mettent en garde les chercheurs.
Cependant, tout le monde ne mange pas plus de viande. Les chercheurs ont découvert que neuf pays de leur échantillon mangent en fait moins, notamment le Nigeria, l’Éthiopie et le Paraguay. Dans ces pays, le déclin semble être dû à l’imprévisibilité des conditions météorologiques et à l’augmentation de l’incidence des maladies, toutes deux accentuées par le changement climatique, qui entraîne un déclin du bétail et limite la disponibilité de la viande.
Mais c’est en examinant de plus près ces neuf pays sous l’angle du PIB que les chercheurs ont fait leur découverte la plus surprenante. Dans trois de ces neuf pays – le Canada, la Suisse et la Nouvelle-Zélande – la hausse du PIB s’accompagne d’une baisse de la consommation de viande. Ce n’est pas une tendance à laquelle on pourrait s’attendre, étant donné qu’un PIB plus élevé reflète généralement un revenu par habitant plus important, ce qui, historiquement, va de pair avec une plus grande consommation de viande, car celle-ci est chère.
Pourtant, pour ces trois pays très riches et à PIB élevé, c’est l’inverse qui est vrai aujourd’hui. En Nouvelle-Zélande, par exemple, la consommation de viande a diminué de plus de 10 kilogrammes par personne entre 2000 et 2019. Même avec une plus grande liberté économique que la plupart des autres pays, il semble que ces nations s’éloignent volontairement du bœuf, du poulet, du porc et du mouton. Ou, comme le disent les chercheurs, ils ont atteint le « pic de viande ».
Qui plus est, il semble y avoir un point de basculement économique précis pour ce changement. Lorsque les chercheurs ont examiné les données, ils ont constaté que, dans les pays où le PIB est lié à la consommation de viande, ce lien ne semble exister que jusqu’à 40 000 dollars de PIB par habitant. Au-delà de ce chiffre, la consommation de viande par habitant commence à diminuer.
Qu’est-ce qui explique ce changement d’attitude à l’égard de la viande dans les pays riches ? Les chercheurs supposent qu’il s’agit d’un ensemble de facteurs, tels que la sensibilisation croissante à la santé, la montée des mouvements de défense des droits des animaux et le végétarisme. La politique semble également avoir joué un rôle important dans des pays comme le Canada, où la limitation de la consommation nationale de viande rouge fait partie d’une stratégie officielle du gouvernement en matière d’alimentation saine.
L’étude ne s’est intéressée qu’au PIB en tant que moteur de la consommation, mais les auteurs notent qu’il existe de nombreux autres facteurs qu’ils n’étaient pas en mesure d’examiner, comme le rôle que jouent la culture et la religion dans l’élaboration des régimes alimentaires. Ces facteurs pourraient jouer un rôle important dans la limitation de la consommation de viande dans de nombreux pays moins riches que ceux dont le PIB est le plus élevé, et leur interaction avec le régime alimentaire et l’impact environnemental mérite d’être examinée dans le cadre de recherches futures, affirment-ils.
En attendant, l’étude actuelle offre deux conclusions principales. Premièrement, nous devons être prudents quant à l’augmentation explosive du poulet. Deuxièmement, on observe aujourd’hui une diminution volontaire de la consommation de viande dans les pays où elle était historiquement la plus élevée, ce qui constitue un précédent encourageant pour la direction que prend le monde. L’évolution des attitudes à l’égard de la viande, combinée à l’augmentation de la consommation de poulet, est un signe encourageant.
Lu dans Anthropocene Magazne
Phillips et. al. “Are We Approaching Peak Meat Consumption? Analysis ofMeat Consumption from 2000 to 2019 in 35 Countries and ItsRelationship to Gross Domestic Product.” Animals. 2021.
Image: ©Anthropocene Magazine
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
 État d'urgence Ce qu'en dit la science
État d'urgence Ce qu'en dit la science